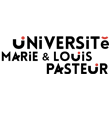Le laboratoire Logiques de l’Agir a le plaisir de vous convier à son séminaire le mercredi 12 novembre 2025 à 18h00 à l’UFR SLHS de l’université Marie et Louis Pasteur en salle E14 (Grand Salon), entrée par le 18 rue Chifflet, 25000 Besançon. Nous recevrons Guillaume Floc’h et Nicolas Antoszkiewicz lors de la treizième séance doctorale du laboratoire Logiques de l’Agir.
Guillaume Floc’h : Vie et thermodynamique chez Bergson et Cournot
Présentation
La notion d’énergie a été une sorte de catalyseur pour les sciences au XIXe siècle. Il s’agira de se demander en quoi celle-ci peut nous aider à retracer la genèse du vitalisme de Cournot (1801-1877) et de Bergson (1859-1941). Dans un second temps, nous nous demanderons dans quelle mesure leur philosophie de la vie a été instruite par la thermodynamique.
Si Cournot ne s’était pas encore intéressé à cette science dans l’Essai (1851), bien qu’il présentait déjà des convictions résolument vitalistes, il y consacre un chapitre dans le Traité (1861). Or, sa connaissance récente des théories énergétiques ne se borne pas à l’étude des propriétés de la matière mais influe fortement sur la manière dont il pense la force vitale. On verra que son intérêt pour la thermodynamique ne doit rien au hasard, mais qu’il y était préparé de longue date par son adhésion précoce au dynamisme leibnizien. Si Leibniz fut toujours le philosophe de prédilection de Cournot, c’est notamment grâce à cette pensée de la force qu’il trouve chez lui, laquelle a le mérite de s’adapter aussi bien au monde la matière qu’au monde de la vie.
Dans la thèse de Bergson, Essai sur les données immédiates la conscience (1889), une part importante du troisième chapitre est consacrée à une discussion avec la thermodynamique. Or si, contrairement à Cournot, cette dernière est d’emblée présente dans l’œuvre bergsonienne, c’est pour remettre en cause certaines de ses prétentions, en particulier l’universalité du principe de conservation de l’énergie. Tout semble indiquer qu’après avoir agi librement il y a dans le moi un gain de l’antécédent au conséquent. Il faut donc postuler l’existence d’une énergie à la fois spirituelle et non-conservative, qui n’est plus du ressort des sciences physiques. Or, dans cette énergie spirituelle, Bergson retrouve les deux aspects complémentaires de la durée : conservation et création. De la sorte, la causalité de l’élan vital pourra plus tard être comprise par analogie avec celle du moi.
Si la question de l’énergie a en quelque sorte préparé nos deux auteurs à leur philosophie de la vie ultérieure, nous verrons que cette thématique continue de les accompagner tout au long de son élaboration. Pour comprendre comment la force vitale met en ordre les forces physiques dans l’organisme, Cournot s’appuie sur des comparaisons tirées de la mécanique industrielle. De la même façon, dans L’évolution créatrice (1907), Bergson montre que le modus operandi de la vie consiste à fabriquer des réservoirs d’énergie dans certains individus (les végétaux), que d’autres se chargeront ensuite de faire exploser (les animaux). Dans le troisième chapitre, enfin, l’analyse du second principe de la thermodynamique montre que la vie suit un sens contraire au mouvement matériel entropique.
Guillaume Floc’h est doctorant au laboratoire Logiques de l’Agir de l’université Marie et Louis Pasteur et réalise une thèse sur Bergson et Cournot sous la direction de Sarah Carvallo.
***
Nicolas Antoszkiewicz : Centralité de l’homme dans l’époque et centralité de l’époque dans l’homme. Le renouvellement du concept de situation historique
Présentation
Le problème de l’historicité constitue une aporie pour la tradition phénoménologique. En effet, il s’agit, en un sens, de définir phénoménologiquement l’eidos de l’histoire à partir des phénomènes qui la caractérisent (la tradition, la pratique sociale comme ouverture d’une tâche infinie, etc.), mais également de manière plus souterraine et difficilement conciliable, de reconnaître que toute intentionnalité, toute manière de percevoir et de penser, est enracinée dans une communauté historique.
En effet, chez Husserl, penser les phénomènes de l’histoire consiste à se rapporter à un monde qui comme condition de possibilité de l’historicité n’est pas lui-même historique : la Lebenswelt – monde de la vie – qui est toujours l’antérieur de tout Umwelt – environnement – particulier. Néanmoins, toute communauté est alors prise dans une simple alternative : répéter convenablement une tâche qui prend son sens à partir de son origine dans le monde de la vie, ou ne pas la réactiver convenablement et en détourner le sens. Ce qui est impensable dans le dispositif husserlien, c’est le fait que la dimension a priori d’une pratique ou d’un phénomène puisse varier en fonction de l’époque ou du lieu.
La position inverse consiste à faire de l’historicité le seul a priori, au sens où l’on ne pourrait jamais se rapporter au monde autrement que selon les représentations de notre époque, enfermés que nous serions dans notre propre situation. Il est possible de trouver une solution de ce type dans Les Mots et les choses de Michel Foucault. Il s’agit de mettre au jour les ordres sous-jacents à un système d’empiricités. Pour rompre avec le thème d’une histoire de la raison commun à Hegel et Husserl, Foucault étudie l’ordre du savoir à une époque donnée. Dans les Mots et les choses, le mode d’être de l’ordre, c’est l’histoire du mode d’être des signes. Ce qui change c’est le statut ontologique des signes, sans que le changement en lui-même puisse être le thème de l’analyse philosophique.
En somme, il semblerait particulièrement difficile de concilier l’idée d’un a priori de l’histoire avec celle d’une historicité de l’a priori. Notre présentation abordera cette tension à partir de l’œuvre de Jan Patočka, qui propose une redéfinition du concept de situation historique.
Le thème de l’historicité constitue certainement le fil conducteur principal de l’itinéraire philosophique de Patočka. En effet dès 1934, il écrit un texte intitulé « Quelques remarques sur les concepts d’histoire et d’historiographie ». Il y critique les approches rationalistes de l’histoire qui en font un tout cohérent saisissable dans une « intuition parfaite de l’histoire » (p. 139). Il considère en effet, qu’il s’agit d’un « intellectualisme qui dévie le flux temporel ouvert de l’histoire vers l’intemporel » et que « loin de faire apparaitre le phénomène lui-même, ils ont leur source dans une interprétation extrinsèque » (p. 143). Fidèle à la démarche phénoménologique, Patočka refuse toute interprétation extrinsèque et effectue une épokhè de l’histoire, c’est-à-dire qu’il ne veut rien en présupposer d’autre que ce qu’en livre son phénomène. Ainsi, cette présentation suivra l’exploration par Patočka du concept de situation comme manifestation de l’histoire.
Nicolas Antoszkiewicz est doctorant au laboratoire Logiques de l’Agir de l’université Marie et Louis Pasteur et réalise une thèse sur l’œuvre de Jan Patočka sous la direction de Laurent Perreau.